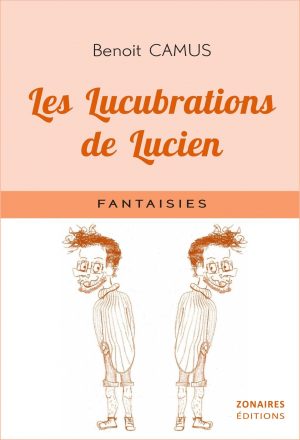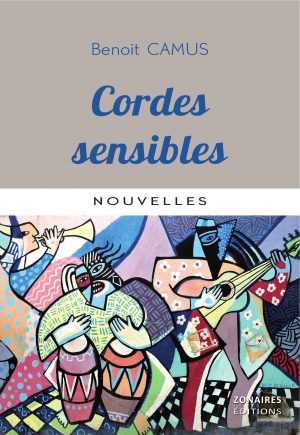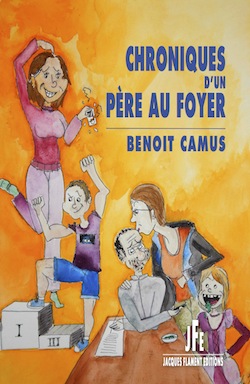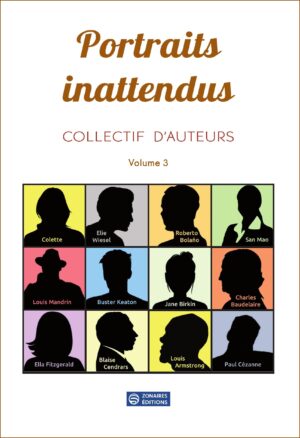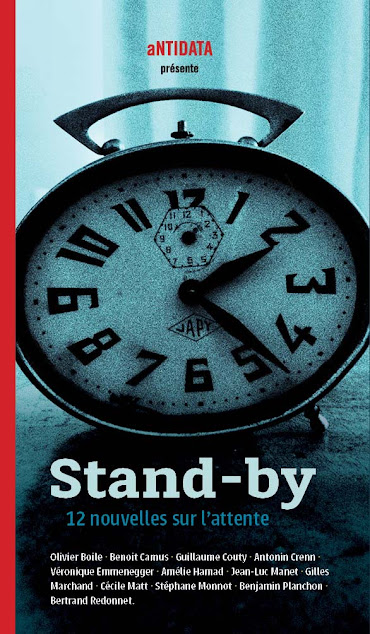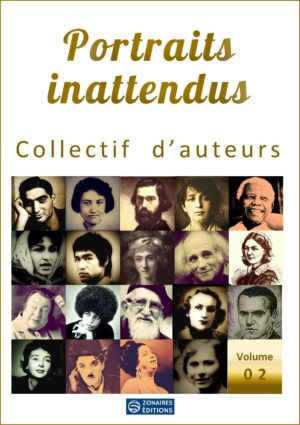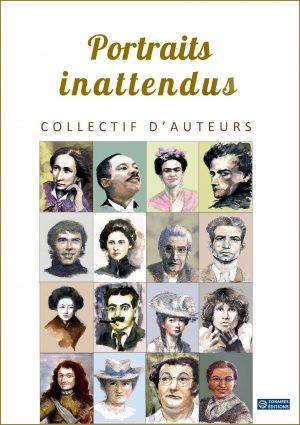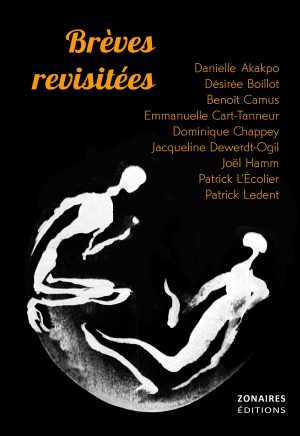-
Les terminaisons nerveuses, aux éditions La clé à molette

Je suis depuis un moment les exigeantes éditions de La clé à molette, et pas seulement parce qu'elles ont le bon goût d'être montbéliardaises. Exigeantes et passionnantes, comme ses rééditions d’œuvres de Dhôtel et plus récemment de Beucler, ou ses publications plus contemporaines : entre autres, les quêtes littéraires et existentielles (ce qui revient ici au même) de Frédérique Germanaud, territoriales et poétiques d'Alexandre Rolla ou de Jacques Moulin, les romans plus narratifs aussi comme celui de Frédérique Cosnier, inspiré de Cassavates, ou comme Les terminaisons nerveuses d'Eric Duboys, objet de ce petit billet.
Le livre est paru en 2016. Il y a un temps certain, donc, surtout à une époque où la durée de vie d'un bouquin ne dépasse guère les 6 mois. Mais le roman d'Eric Duboys est du genre à résister au temps, d'autant qu'il restitue celui perdu de nos campagnes.
Je sais bien que les références à d'autres écrivains, surtout quand ceux-là traînent dans leur sillage une réputation écrasante, sont peu pertinentes, mais tout de même, quand elles nous taraudent autant à la lecture, l'on ne peut s'empêcher d'y trouver une certaine forme de justesse. Et les raccourcis, aussi superficiels soient-ils, permettent un éclairage bien plus parlant que dix pages d'argumentation. Et là, donc, on y est : c'est Proust chez Faulkner. Proust, non pas tant à cause du "temps perdu" – encore que – que du fait de l'écriture, des longues phrases à enchâssements, arabesques à la précision d'entomologiste cernant son sujet, se refermant sur lui, et de la distanciation (et partant, de l'humour) qu'elles induisent. Alors que le champ d'observation de Proust était la haute société, celui de Duboys est plus terre à terre. Et c'est là qu'on rejoint Faulkner (ou Steinbeck... mais je préfère Faulkner...). Le monde décrit, celui de nos campagnes, il y a quelques années, est brutal et ensauvagé, marqué par l'égoïsme, le patriarcat et, dans ses recoins les plus pauvres et sombres, par la bestialité. C'est qu'en ce temps-là, l'on vivait comme des bêtes. Le narrateur évoque sa famille, nous guide dans une galerie de portraits, figures saisissantes où toutes les tares sont réunies pour composer un tableau d'humanité pourrissante. Le grand-père, le père, Bernard en constituent des repères particulièrement saillants, jalons de la trajectoire d'une famille relatée par l'un de ses rejetons, dont le regard en surplomb, plein d'acuité et sans complaisance, se laisse parfois brouiller par un semblant d'affection (ou de compassion) à l'égard d'un des protagonistes, Antoine, par exemple. Le décalage entre le style policé (civilisé ?) et recherché et le monde fruste, frustré et malade de lui-même, représenté, ajoute à la fascination qu'exerce l'ouvrage sur le lecteur, quitte à instiller chez lui un certain malaise. Car le décalage est tel qu'il aliène – aliénation des personnages réduits à leurs névroses, qui se débattent dans leurs milieu et dont le narrateur entomologiste détaille les dérèglements (nerveux ou pas). Il trahit une mise à distance, un détachement pas loin du mépris, dont on comprend finalement, et ébranlé, qu'il constitue surtout une carapace (vitale) pour le narrateur. Le roman d'Eric Duboys, indéniablement, marque l'esprit.Les terminaisons nerveuses, d'Eric Duboys, aux éditions La clé à molette, à commander dans toutes les bonnes librairies.
 Tags : Eric Duboys, La clé à molette
Tags : Eric Duboys, La clé à molette
-
Commentaires
Agitez la boule et il tombera beaucoup de mots, quelques images et même un peu de sons.