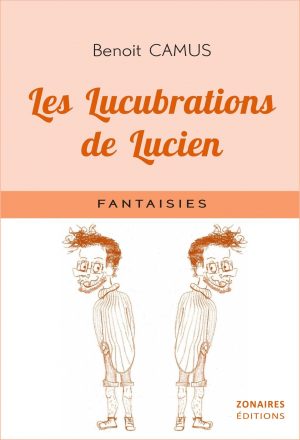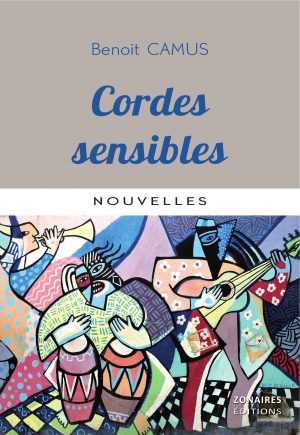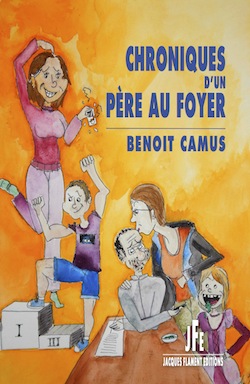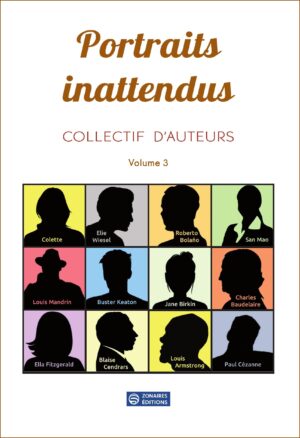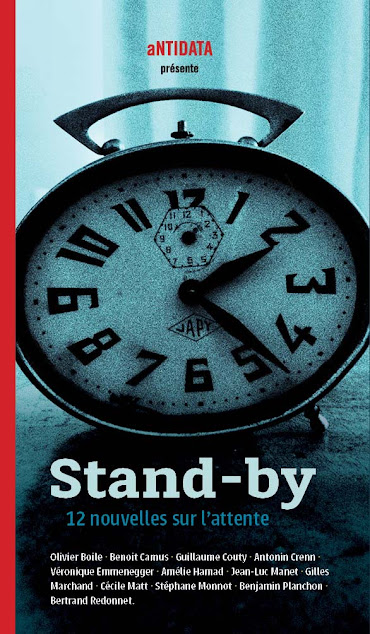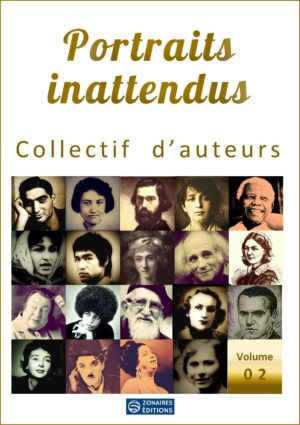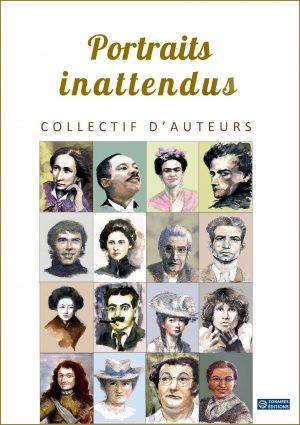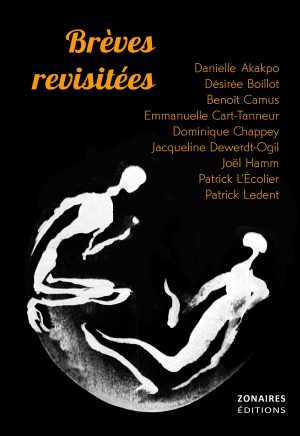-
Le grand saut
Ce moment vertigineux où l'on jette les premières lignes de son nouveau roman, sans trop savoir où elles vont mener, ni même si elles mèneront quelque part. Comme un saut dans le vide, dont on a une idée de la trajectoire mais qui peut prendre des orientations imprévisibles. On ira au bout, la crainte n'est plus là, on a déjà tenté ce genre de voyage et l'on a toujours fini par dépasser le point final. La question est comment et dans quel état. Sur quoi cela débouchera-t-il et en sortira-t-on fracassé ? On est jamais certain du périple et le risque de se perdre est immense. Des heures, des jours, des mois de travail pour un résultat susceptible de rejoindre la plupart des précédents, dans un tiroir ou sur une étagère, et de seulement alourdir de quelques kilooctets supplémentaires le dossier "écritures" de son ordinateur.
C'est sans doute cette incertitude qui différencie principalement et indépendamment de toute considération esthétique l'écrivant (ou l'écrivaillon) de l'écrivain. Ce dernier a conscience qu'il n'écrit pas pour "rien". D'une manière ou d'une autre, là ou ailleurs, le texte sur lequel il planche, n'importe lequel, trouvera preneur et sera éclairé (aussi ténu soit le rayonnement). S'agissant de l'écrivant, rien n'est moins sûr. Il espère la lueur mais s'empêche d'y croire, car il est déjà passé par là, s'est déjà cogné au mur de la réalité. Il écrit, consacre énormément de temps à sa tâche a-priori (statistiquement) pour l'obscurité, pour l'ombre immédiate et poussiéreuse des fonds de caves (avant de provisoirement rejoindre celui des poubelles). Je crois que, dans ces conditions, l'on n'écrit pas de la même façon. Il est impossible d'écrire de la même manière selon que l'on sait que la publication est au bout ou qu'on ne le sait pas. L'urgence, le sentiment de précarité, de tension, ne sont pas de même nature. Certes, réside dans les deux cas la nécessité de se dépasser, que ce soit dans le premier pour renverser les murs ou, dans le second, pour confirmer (ou ne pas décevoir) et creuser son sillon mais l'enjeu n'est pas le même. Pour l'écrivant, écrire revient à jouer son existence (le néant menace) et relève d'une quête ontologique. Chaque mot qu'il ajoute le rapproche du vide et plus il en ajoute, plus ce vide qui le guette gagne en ampleur. Il ne joue pas sa peau mais se joue soi-même et sa raison d'être ou d'avoir été pendant tout le temps passé à écrire. Plus ce temps est long, plus il prend le risque de l’annihilation (tout ça pour rien !). Et bien des fois, le doute l'assaillira ; il sera tenté d'abandonner et de se tourner vers des cimes d'accès plus rapides (comme d'écrire une nouvelle), aussi pentues soient-elle, dont la brièveté de l'escalade lui apparaîtra plus supportable et moins absurde. Pour l'écrivain, c'est tout le contraire. C'est de ne pas écrire qui rend précaire sa situation et le menace. Son angoisse est celle de la page blanche. Il craint de ne plus être à la hauteur, de ne plus y arriver. Ainsi, à la différence de l'écrivant, chaque mot supplémentaire étaiera son parcours en le légitimant et le confortera dans son rôle, dans son être au monde, lui apportera une relative "sécurité existentielle". Et il se consacrera tout entier à son oeuvre, puisque celle-ci, par son avènement et sa divulgation certaine, le justifiera.Je me lance, me risque des mois comme fantôme.
-
Commentaires
Agitez la boule et il tombera beaucoup de mots, quelques images et même un peu de sons.