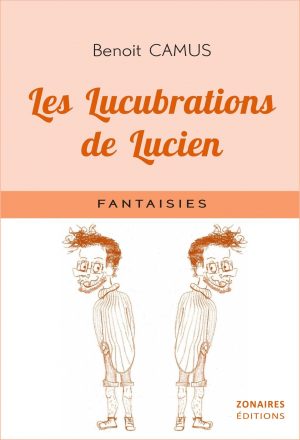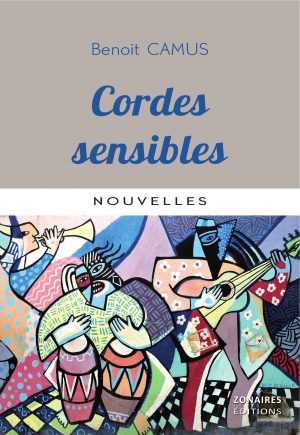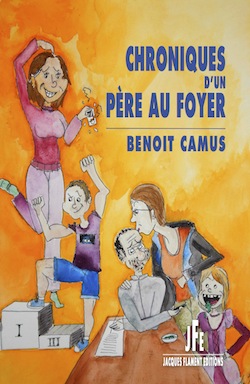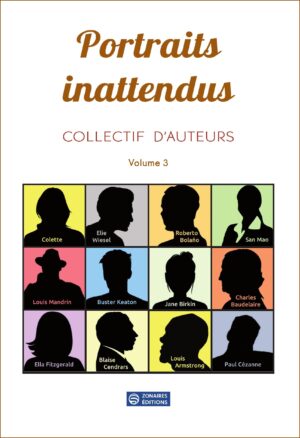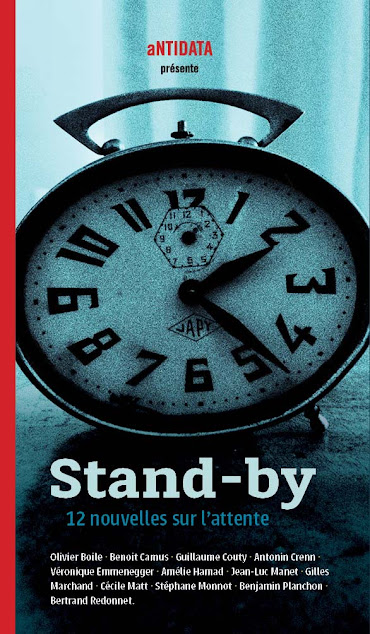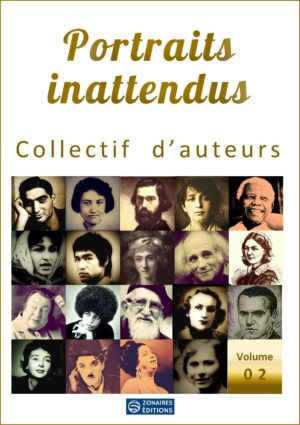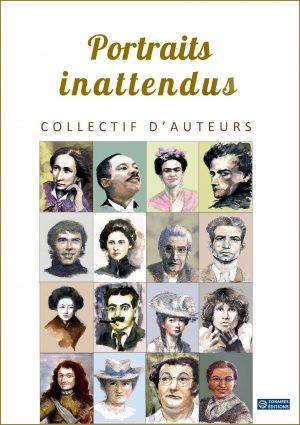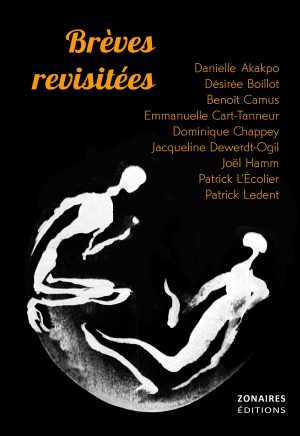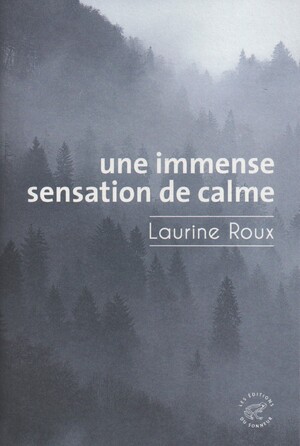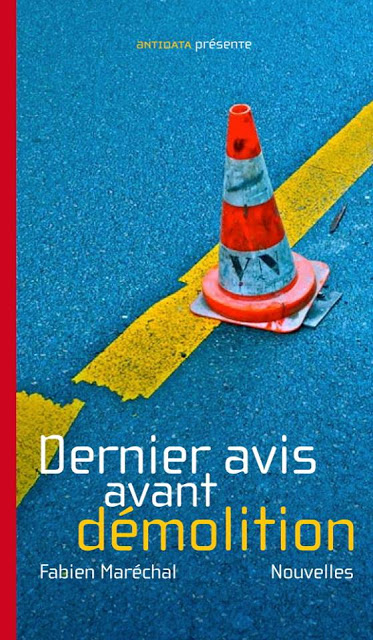-
Par Pilgrim. le 20 Avril 2023 à 10:30
Extrait d'un message adressé à M. Bruimaud, auteur d'Avant le crépuscule, publié aux éditions Jacques Flament :
« ... j'ai lu Avant le crépuscule et, comme promis, je vous en touche quelques mots. Je le fais d'autant plus facilement que je l'ai beaucoup apprécié. Votre travail, votre insistance à creuser votre sillon, à cerner votre sujet, forcent l'estime. L'on pourrait croire le tour de la question fait et refait, la trame usée jusqu'à la corde ; or tels ces peintres qui reviennent toujours sur le même motif ou thème, mais en changeant d'angles, en décadrant ou en focalisant sur un aspect donné, ou en s'imposant une contrainte esthétique ou formelle (ici un dialogue sans didascalie), vous n'épuisez pas le sujet, au contraire le renouvelez. L'on pourrait redouter aussi que vous sombriez, à force, dans cette complaisance (plaintive et/ou autojustificative) qui ruine tant d'autofictions et qui fait bâiller d'ennui ; vous évitez l'écueil avec élégance, et par une autodérision bienvenue et non truquée, celle où l'acuité du trait ne vous épargne pas (à la différence de ceux qui brandissent l'autodérision en étendard mais pour mieux se mettre en avant : « voyez comme je suis lucide et intelligent ; voyez (et admirez !) comme je sais rire de moi ! »). Car vous ne craignez pas (n'en avez certainement rien à faire) l'image que votre œuvre pourrait renvoyer de vous et c'est tant mieux pour le lecteur.
Il y a déjà un moment que j'ai lu La vie coule ainsi que certains textes que vous avez écrits pour des revues ou des collectifs (Métèque, Le cafard hérétique, chez JFE... il me semble, entre autres) (je mets à part Makolet qui est le premier ouvrage de vous que j'ai découvert) et c'est avec plaisir et un évident sentiment de familiarité que j'ai retrouvé vos protagonistes (et peu m'a importé de démêler le vrai du faux, la réalité de la fiction ; cela n'étant pas un problème de lecteur mais d'un voyeur), et particulièrement votre double, parfois irritant du fait de son égocentrisme (il faut l'admettre) mais terriblement attachant. Vous évoquez plusieurs fois Doinel, lui aussi alter ego de son créateur, et le parallèle avec lui, effectivement, tombe sous le sens (d'autant qu'il y a voisinage entre votre œuvre et la série truffaldienne). Il y a dans votre personnage cette inconscience, cette candeur destructrice (et enfantine), cette intransigeance mâtinée de mauvaise foi également, de Doinel qui n'imagine pas (et s'en étonne quand l'évidence lui saute aux yeux) blesser les autres (les femmes, surtout) en cherchant son bien, son intérêt ou son plaisir à lui, et malgré lesquels il est impossible de lui en vouloir. Et puis, enfin, il faut mentionner le plaisir de lecture qui coule comme la vie et que vos abondantes références culturelles rendent très attrayante... »L'on peut se procurer Avant le crépuscule de Marc Bruimaud en librairie ou plus directement, sur le site de l'éditeur Jacques Flament, où l'on trouvera aussi d'autres livres de l'auteur, dont Ma racontouze, qui vient d'être publié.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Pilgrim. le 15 Novembre 2020 à 10:30
L'humour est la politesse du désespoir, dit-on. Le recueil de Dominique Theurz, qui porte bien son titre, en est la démonstration. La légèreté apparente des situations, de la forme littéraire, accompagne une détresse intérieure des personnages et la rend d'autant plus poignante. Il y a de la pudeur, de l'élégance, une certaine classe, même, dans cette façon qu'à l'auteure d'aborder, l'air de n'y pas toucher, sur le fil, des sujets douloureux.
Dominique Theurz y parvient grâce à une écriture au cordeau. Rien de trop. Des nouvelles ciselées qui requièrent du temps au lecteur, qui réclament qu'il s'y arrête car, ici, chaque mot compte. Une justesse et une efficacité qui rappellent celles des meilleurs fabulistes. Et, à n'en pas douter, il y a de cela, dans ces textes, un air de fable, et non pas tant par le recours fréquent à la personnification animale (d'insectes, notamment) ou d'objets mais par la simplicité (apparente) et l'universalité du propos. Un travail d'orfèvre.
À l'aigre-douce est paru en 2018. Il serait dommage de passer à côté. À découvrir, sans hésitation !
Le recueil, À l'aigre-douce de Dominique Theurz, aux éditions Alter Real, ici. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Pilgrim. le 20 Mai 2020 à 10:30
 Depuis plusieurs années les éditions Ska tracent leur sillon numérique en offrant à la nouvelle un bel espace d'expression. Une large place y est faite à la littérature de genre avec une forte prédilection pour le noir et le rose. Les éditions ne rechignent pas, cependant, à s'en éloigner pour s'ouvrir à des propositions aux frontières moins claires. Soudain, partir, la nouvelle de Frédérique Trigodet (collection Noire Sœur) est l'une d'elle.
Depuis plusieurs années les éditions Ska tracent leur sillon numérique en offrant à la nouvelle un bel espace d'expression. Une large place y est faite à la littérature de genre avec une forte prédilection pour le noir et le rose. Les éditions ne rechignent pas, cependant, à s'en éloigner pour s'ouvrir à des propositions aux frontières moins claires. Soudain, partir, la nouvelle de Frédérique Trigodet (collection Noire Sœur) est l'une d'elle.
L'on connaît la nouvelliste, sa curiosité enthousiaste et son attrait pour la littérature, toute la littérature, sa jubilation à se colleter à des genres variés (voire opposés) sans jamais se laisser enfermer dans un seul. Et c'est sans doute l'une des grandes forces de l'auteure que de n'être jamais où on l'attend, où on pourrait l'attendre. Soudain, partir oscille entre les frontières des genres. N'importe quand, le texte est susceptible de verser dans l'un ou l'autre, tant Frédérique Trigodet en connaît les ressorts et sait jouer avec les clichés (la nuit, la rue, un port, l'errance nocturne et les rencontres afférentes) qui les caractérisent. Elle en évite soigneusement les écueils ; mieux : s'en sert pour développer sa narration et son sujet et attiser l'intérêt du lecteur. Car c'est à une analyse psychologique que se livre l'auteure (un suspense psychologique). Le personnage féminin arrive à un de ces moments cruciaux dans une vie qui peut la faire basculer. La tension qui court durant toute la nouvelle est relative à ce basculement et à l'incertitude qui la concerne. Et on le pressent, tout peut arriver. L'auteure, avec une parfaite maîtrise, use du procédé narratif et d'une écriture limpide et sans fioritures pour se livrer à une étude de personnage des plus profondes et subtiles. Et la grande réussite de ce texte est là, dans ce portrait de femme et la sensibilité avec laquelle il est peint. Tout sonne juste et, à mesure que les traits se précisent, que les failles et les rêves enfouis affleurent, l'attachement grandit. L'humanité qui s'en dégage est telle qu'à la fin on en garde une impression durable.
Soudain, partir, l'excellente nouvelle de Frédérique Trigodet est parue chez Ska Éditions. On peut la trouver dans toutes les bonnes librairies numériques, notamment ici. 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Pilgrim. le 15 Septembre 2019 à 10:30

Je suis depuis un moment les exigeantes éditions de La clé à molette, et pas seulement parce qu'elles ont le bon goût d'être montbéliardaises. Exigeantes et passionnantes, comme ses rééditions d’œuvres de Dhôtel et plus récemment de Beucler, ou ses publications plus contemporaines : entre autres, les quêtes littéraires et existentielles (ce qui revient ici au même) de Frédérique Germanaud, territoriales et poétiques d'Alexandre Rolla ou de Jacques Moulin, les romans plus narratifs aussi comme celui de Frédérique Cosnier, inspiré de Cassavates, ou comme Les terminaisons nerveuses d'Eric Duboys, objet de ce petit billet.
Le livre est paru en 2016. Il y a un temps certain, donc, surtout à une époque où la durée de vie d'un bouquin ne dépasse guère les 6 mois. Mais le roman d'Eric Duboys est du genre à résister au temps, d'autant qu'il restitue celui perdu de nos campagnes.
Je sais bien que les références à d'autres écrivains, surtout quand ceux-là traînent dans leur sillage une réputation écrasante, sont peu pertinentes, mais tout de même, quand elles nous taraudent autant à la lecture, l'on ne peut s'empêcher d'y trouver une certaine forme de justesse. Et les raccourcis, aussi superficiels soient-ils, permettent un éclairage bien plus parlant que dix pages d'argumentation. Et là, donc, on y est : c'est Proust chez Faulkner. Proust, non pas tant à cause du "temps perdu" – encore que – que du fait de l'écriture, des longues phrases à enchâssements, arabesques à la précision d'entomologiste cernant son sujet, se refermant sur lui, et de la distanciation (et partant, de l'humour) qu'elles induisent. Alors que le champ d'observation de Proust était la haute société, celui de Duboys est plus terre à terre. Et c'est là qu'on rejoint Faulkner (ou Steinbeck... mais je préfère Faulkner...). Le monde décrit, celui de nos campagnes, il y a quelques années, est brutal et ensauvagé, marqué par l'égoïsme, le patriarcat et, dans ses recoins les plus pauvres et sombres, par la bestialité. C'est qu'en ce temps-là, l'on vivait comme des bêtes. Le narrateur évoque sa famille, nous guide dans une galerie de portraits, figures saisissantes où toutes les tares sont réunies pour composer un tableau d'humanité pourrissante. Le grand-père, le père, Bernard en constituent des repères particulièrement saillants, jalons de la trajectoire d'une famille relatée par l'un de ses rejetons, dont le regard en surplomb, plein d'acuité et sans complaisance, se laisse parfois brouiller par un semblant d'affection (ou de compassion) à l'égard d'un des protagonistes, Antoine, par exemple. Le décalage entre le style policé (civilisé ?) et recherché et le monde fruste, frustré et malade de lui-même, représenté, ajoute à la fascination qu'exerce l'ouvrage sur le lecteur, quitte à instiller chez lui un certain malaise. Car le décalage est tel qu'il aliène – aliénation des personnages réduits à leurs névroses, qui se débattent dans leurs milieu et dont le narrateur entomologiste détaille les dérèglements (nerveux ou pas). Il trahit une mise à distance, un détachement pas loin du mépris, dont on comprend finalement, et ébranlé, qu'il constitue surtout une carapace (vitale) pour le narrateur. Le roman d'Eric Duboys, indéniablement, marque l'esprit.Les terminaisons nerveuses, d'Eric Duboys, aux éditions La clé à molette, à commander dans toutes les bonnes librairies.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Pilgrim. le 10 Mars 2019 à 10:30
Un recueil que la mort hante. Où les personnages sont comme des insectes cernés. Pris dans les filets de leur destin. Ou dans les barbelés. C'est selon. Bouffons de la fortune, dirait Roméo. Le Fatum auquel on se heurte et qui emprisonne ses proies. L'absurdité de l'existence, la vanité que c'est de se débattre contre l'inéluctable. D'où le sentiment d'enfermement qui domine, tout le long de la lecture. L'on s'échine à fixer la vie sur une photo, un tableau. L'un ira même jusqu'à inséminer son oeuvre pour la lui insuffler mais la mort est têtue et la vacuité du geste inexorable. C'est toujours une image de la mort qu'on obtient et finalement des gisants qu'on fixe sur pellicule. Ces trois photos seront aussi mystérieuses que la centaine d'autres qui dorment dans le sac de toile. Tous ces sourires sans nom qui peuplent la surface argentique finiront par disparaître aussi bien que les corps qui y ont laissé leur trace. Ce n'est qu'une question de temps (extrait de Faussaire). Et l'on aura beau tenter de les faire revivre ces morts, comme Elisa par le prisme de ses jumelles, c'est peine perdue. Seuls les mots pourront quelque chose et donner le change... Sauver une trace, la mémoire, un souvenir. Ainsi dans la dernière nouvelle du recueil où l'homme, zombi tant qu'il vivait, trouve à s'incarner et s'anime (au sens premier du terme) à travers son dernier message. Seuls les mots et peut-être aussi les grands-mères, personnages récurrents, un peu sorcières un peu fées, qui offrent un ancrage dans la vie et la possibilité d'une île.
Tout le recueil est irrigué par ce sens du tragique et c'est ce qui en fait, selon moi, la réussite et la profondeur. Profond et émouvant, comme ce magnifique texte Temps de chien, sans doute mon préféré, qui fait écho à un autre, souvenir d'enfance, où était déjà annoncée la mort du père, mort dont l'ombre plane sur les protagonistes décidément humains, trop humains.Le recueil de nouvelles, Ivresse de la chute, de Joël Hamm est disponible sur le site des éditions Zonaires.
 6 commentaires
6 commentaires
-
Par Pilgrim. le 21 Juillet 2018 à 10:30
Je ne suis pas un lecteur de fantasy. De fantastique ou de SF, oui... mais pas de fantasy. Je l'apprécie de temps à autre au cinéma. J'y prends du plaisir et puis je m'en tiens là. Sans doute parce que les quatrièmes de couverture que j'ai parcourues m'ont laissé l'impression que l'on me resservait toujours la même histoire de quête, de rivalité ou d'initiation avec toujours les mêmes ingrédients et les mêmes artifices, que l'on rebattait toujours le même chemin narratif très balisé, ce qui me semble être le comble pour un ouvrage sensé vous ouvrir les portes d'un imaginaire et d'un ailleurs renouvelés. Sans doute aussi parce que les quelques pages feuilletées au gré des occasions m'ont paru ternes et fades, sans relief, d'une écriture au mieux basique quand elle n'était pas indigente... bref, en contradiction totale avec les invitations au voyage que l'on prétend nous offrir... Oui, mais voilà, il a suffi que je tombe sur quelques lignes de Nathalie Vignal pour balayer mes réticences ! J'ai eu cette chance au cours de mes pérégrinations sur le net et je m'en réjouis encore.
Les Maîtres de Pierre - Sâar, publié aux éditions L'Ivre-Book, est le premier volet d'une saga dont j'attends avec impatience la suite. Ça foisonne, ça fourmille ! L'auteure construit avec un grand sens du détail un univers élaboré où entrent en scène de nombreux personnages qu'elle fait exister en quelques lignes. Elle évite la caricature et le manichéisme et propose des caractères à la psychologie étudiée et complexe. Elle noue, croise les fils de sa trame, multiplie les enjeux, les mobiles, les embûches et les péripéties, posant les fondements d'une vaste fresque et la déployant. Elle respecte les codes du genre, intègre dans son récit les thèmes récurrents et emblématiques de la fantasy, se collette aux figures imposées pour se les approprier et s'en tirer avec brio et inventivité.
Mais ce qui est le plus réjouissant et constitue à mon sens la grande réussite de cette belle entreprise littéraire, c'est la langue, le style qu'elle invente, entre modernité et tournures à l'ancienne (qui évoquent les récits médiévaux), assorti d'une très grande richesse sémantique, en parfaite cohérence avec l'univers décrit. La forme originale, à part, presque étrange, devient incarnation du monde proposé et lui donne vie. L'un produit l'autre et petit à petit, en devient le reflet. Il est rare qu'à ce point le verbe colle à son sujet, se lie à lui de façon si indissociable et exclusive. L'auteure a bel et bien réussi son coup : elle nous entraîne dans son aventure, sur les pas de Drayne, Zhara, Yoran ou Jaede, nous embarque dans son univers parallèle ; on est ailleurs... et à la fin, on a très vite envie d'y retourner.Alors, non, je ne suis peut-être pas un lecteur de fantasy (quoique...) mais un lecteur de Nathalie Vignal, ça, oui !!! Et pour longtemps...
Les Maîtres de Pierre, Sâar, Tome 1, de Nathalie Vignal aux éditions L'Ivre-Book, à lire sans hésitation, en e-book ou en papier !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Pilgrim. le 21 Avril 2018 à 10:30
Origines et naissance du mythe. Il s'agit là de refonder le monde et de lui trouver une nouvelle géographie de l'âme après la dévastation de l'ancien. La femme raconte son amour pour Igor, l'homme né de l'union de l'eau et de la terre, de la femme poisson et de l'homme ours, figé dans une nature atemporelle et matricielle qui a recouvré sa toute puissance magnifique. Matricielles, comme le sont ces figures féminines qui portent la parole, la connaissance et la mémoire, femmes griot, femmes chamans, medicine women ou baba yaga détentrices des secrets de l'univers, alors que les hommes, muets ou aveugles, restent "englaisés" dans leur animalité et leur environnement. Car la nouvelle humanité naîtra des femmes et elles la bâtiront sur le corps mythique d'Igor.
Il s'agit bien d'un roman postacopocalyptique mais davantage qu'à Cormac Mc Carthy et à La route, l'on songe à Antoine Volodine et à son post-exotisme ainsi qu'à Sylvie Germain et notamment à son A la table des hommes (sa première partie, notamment), tant par l'écriture, précise, limpide et poétique de Laurine Roux (dont on connaissait déjà le très grand talent (voir ici)) qui confère à ce roman une beauté poignante et une atmosphère étrange, que par la place primordiale qui est réservée à la nature (on pensera ici à Thoreau et Giono, pour ne citer qu'eux), personnage à part entière dont le lecteur, à l'instar des héros du livre, ne peut qu'accepter l'emprise. Il émane tout au long et à la fin de de ce superbe texte une mélancolie paisible qui bouleverse et qui le rend essentiel.Une immense sensation de calme, de Laurine Roux, aux éditions Le Sonneur, dans toutes les librairies.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Pilgrim. le 21 Janvier 2018 à 10:30
La ville où l'on n'arrive jamais, pourrait être le sous-titre de ce roman obsédant et obsessionnel. L'auteur, Quentin Leclerc, reprend les codes des jeux vidéos (comme il le revendique lui-même dans la présentation de l'ouvrage) et embarque le lecteur dans le ressassement d'une même partie où chaque variation de trajectoire induira une modification du scénario et où le vacillement du protagoniste (ou du lecteur) provoquera son renvoi à la case départ, le village en l’occurrence, lieu monstre et protéiforme, duquel on ne parvient à s'échapper. Il s'agit de rejoindre la ville alors que la ville fond, quête qui vire à l'absurde, désespérée et vouée à l'échec quand le monde se désagrège, qu'à chaque tentative des pans du décor se dissolvent comme dans ce film de Kiyoshi Kurosawa, Real, où le délitement progressif du monde représente celui, strate par strate, du subconscient du héros. C'est un peu comme si Vladimir et Estragon¹ attendaient Godot sur La route, comme si Samuel Beckett endossait l'univers et le costume de Cormac McCarthy. Et ça fonctionne ! Cela fonctionne tellement bien que l'empreinte du livre sur le lecteur est profonde et que persistent, longtemps après l'avoir refermé, les images mentales suscitées. Un road trip très réussi !
La ville fond de Quentin Leclerc, aux Editions de l'Ogre.
¹Personnages d'En attendant Godot, de S. Beckett
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Pilgrim. le 11 Janvier 2017 à 10:30
C
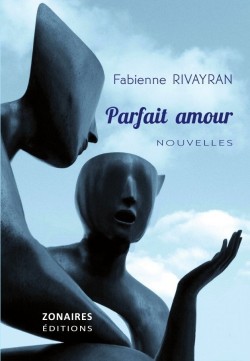 arver en exergue de ce recueil de nouvelles, c'est l'évidence. Ici aussi, les gens sont cabossés, perdus ou invisibles. Ici aussi, l'incommunicabilité mine les relations humaines. Des personnages seuls, sur le fil, en recherche d'eux-mêmes, en quête de sens, qui se cognent contre les murs, se cognent contre les autres (et leur insondable et ontologique étrangéité).
arver en exergue de ce recueil de nouvelles, c'est l'évidence. Ici aussi, les gens sont cabossés, perdus ou invisibles. Ici aussi, l'incommunicabilité mine les relations humaines. Des personnages seuls, sur le fil, en recherche d'eux-mêmes, en quête de sens, qui se cognent contre les murs, se cognent contre les autres (et leur insondable et ontologique étrangéité).
Fabienne Rivayran se penche sur nous, sur notre voisin, sur ceux qu'on ne voit pas et pose un regard aigu sur notre condition. Un regard lucide, sans concession mais qui n'a rien d'accablant, car l'auteure se garde bien de s'immiscer. Elle accompagne, elle se met à la place de. Et c'est sans doute là que réside la principale réussite de ce recueil, dans la faculté qu'a la nouvelliste de se mettre dans la tête de ses protagonistes, de suivre les linéaments de leurs pensées en se posant sur tel élément du décor, en s'attardant sur un menu ou sur la couleur d'une robe, en revenant aux préoccupations des personnages. La nouvelle "Deux jours sans rien faire" est à cet égard un modèle de maîtrise car il en faut de la maîtrise pour rendre l'état de conscience d'un personnage, sinuer dans les méandres de ses pensées, passer d'une observation simple à un souvenir, à une angoisse, sans qu'aucun artifice ni aucune ficelle n'apparaisse. C'est fluide, c'est cohérent et on touche à l'essentiel alors que rien n'est explicitement dit ni démontré.Parfait amour est un recueil de nouvelles de Fabienne Rivayran, paru chez Zonaires Editions, à se procurer ici.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Pilgrim. le 10 Juin 2016 à 10:30
Focus sur les éditions Antidata et deux de ses recueils de nouvelles : Au-delà des halos de Laurent Banitz et Dernier avis avant démolition, de Fabien Maréchal.
L'étrangeté, dans ces deux recueils, règne en maître. Il s'immisce dans des vies à la banalité apparente, dans des situations ordinaires, vient enrayer la routine d'existences tracées. Un hiatus s'opère, le décalage porté par un humour jamais en défaut provoque le malaise, l'inquiétude ou le rire (parfois jaune). Un lien indéniable, donc, entre ces livres, d'autant qu'ils sont tout deux portés par une écriture fluide et sans fioriture, un air de famille qui ne masque ni une différence de traitement ni une spécificité des points de vue et du propos.
Laurent Banitz met ses personnages à rude épreuve, les confrontant à des situations extraordinaires, fantastiques, souvent absurdes. Avec un art consommé du découpage (quasi cinématographique) et du rythme, un style élégant et pince-sans-rire et le sens de la formule, il fait oeuvre d'entomologiste (ou de clinicien). Ses héros sont passifs et impuissants. Ils subissent les événements, s'y adaptent, les intègrent dans leur schéma de vie, de pensée, se laissant portés par eux, même si ou, plutôt, parce qu''ils n'y comprennent rien (l'impressionnant Céphalées) ; et les faits s'enchaînent selon une logique que les circonstances exceptionnelles imposent (Divan mutique). Mais si le monde bascule et les repères se brouillent, c'est aussi pour dépasser les apparences et révéler aux protagonistes leur seconde nature, notamment par la figure du double (mimétique ou transgressif), récurrente (du tentateur de De l'insecticide dans le confessionnal au poilu de Tripes et boyaux en passant par le patient mutique ou l'alter ego de cinéma, ses représentations abondent). Une inversion s'opère. Les masques tombent et le héros, jouet de la fortune, aliéné, devient petit à petit l'ombre de son double, le double de son double.
Chez Fabien Maréchal, ce sont les personnages qui sont à l'oeuvre et à l'origine du détournement de la norme. Par leur conduite, leur volonté, leur éthique de vie, ils se placent en marge de la société et tordent le réel afin qu'il soit plus en phase avec leurs aspirations, afin d'en faire bouger les lignes. Ainsi Norbert (dans Démolition) peint-il son monde aux couleurs d'un futur utopique avant de le teinter du sépia d'un passé idéalisé, avec pour motif du temps qui file et point d'ancrage dans un présent inconciliable : le cimetière, l'extension du domaine de la mort. Ainsi Paulin, le photographe (dans Le monographe), recompose-t-il par son œil le monde qui l'entoure, en lui conférant une dimension sauvage et mythique. Le récit prend un tour quasi fantasmagorique voire épique, alors que se succèdent non-événements et petits riens. Le décalage plonge le lecteur dans un état second et rend la nouvelle particulièrement étonnante, d'autant que l'auteur sait à merveille instaurer des "climats", des atmosphères et y glisser des singularités (le froid glacial dans La guerre froide, l'objet du voyage dans Le grand départ) qui viennent troubler le jeu et déporter le regard.
Deux recueils à découvrir aux éditions Antidata et à commander dans toutes les bonnes librairies.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Agitez la boule et il tombera beaucoup de mots, quelques images et même un peu de sons.